Balade cyclo

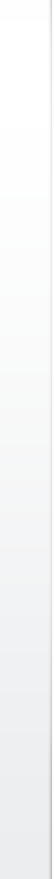

La sortie cyclo prendra son départ sur le parking de l'aire de jeu de Velle à 10 h00
Le circuit sera de moindre difficulté, avec passage dans des chemins de terre et sur route.
Les côtes seront montées à pieds pour ceux qui le souhaite.
La balade est de 10 km environ, avec visite de des ruines de Bel Champs et histoire de la voie antique qui passait par là.
Cette activité est gratuite
Nous serons de retour vers midi.
Au passage, un peu d'histoire sur les ruines que nous croiserons, en particulier l'Abbaye de BelChamps


L'HISTOIRE DE L'ABBAYE DE BELCHAMP par M. Henri LEPAGE
Introduction
Les maisons religieuses qui s'élevaient en grand nombre dans notre pays, ont presque toutes disparu à l'époque de la Révolution, laissant à peine des traces de leur existence. Ici, leurs églises ont été démolies, et les matériaux utilisés dans de nouvelles constructions ; là, elles servent de granges ou d'écuries ; ailleurs, les bâtiments conventuels, dégradés et mutilés, se sont transformés en habitations particulières. Les terres que les moines avaient défrichées et qu'ils faisaient cultiver, après les avoir, dans l'origine, cultivées de leurs propres mains, ces terres ont été vendues et divisées en une infinité de lots. Quelques-uns de nos anciens monastères sont tombés entre les mains de propriétaires intelligents chez qui les idées nouvelles n'ont pas détruit le respect des choses du passé et dos monuments qui en perpétuent le souvenir, et ils ont tenu à l'honneur de conserver, aussi intacts que possible, ces précieux débris des vieux âges. C'est ce qui est arrivé, entre autres, pour la chapelle de la commanderie de Saint-Jean, que des vandales parlent de renverser, et pour l'antique abbaye de Sainle-Marie-au-Bois, dont notre regretté confrère Aug. Digot nous a laissé une si intéressante description. Mais ce sont là de rares et heureuses exceptions, dignes d'éloges. Presque partout, on s'est plu à bouleverser sans rien laisser debout : les églises ont été impitoyablement démolies, et leurs ornements détruits ou dispersés ; on a brisé les tombeaux avec les œuvres d'art qui les décoraient, et, aujourd'hui, nous recueillons comme des reliques les débris de sculpture qui ont échappé à cet aveugle délire de destruction.
La fondation de Belchamp
L'abbaye de Belchamp a partagé le sort de celles de Beaupré, de Clairlieu et de tant d'autres; mais, par un privilège tout particulier, elle a comme survécu à sa ruine, grâce au talent d'un de ses moines, qui nous en a laissé la perspective et la planche ci-dessus, dessinée par M. Louis Benoit et gravée par M. Emile Thiéry. Aussi, quoiqu'elle ait été ruinée de fond en comble, on pourrait aisément la rebâtir telle qu'elle était au siècle dernier, avec ses deux tours qui s'élevaient majestueusement vers le ciel, avec le vaste enclos qui l'enfermait, avec la vigne et le verger qui servait de promenade à ses religieux.
Autre chose a survécu encore : ce sont les titres formant une importante série de nos Archives qui constituent son histoire, et à l'aide desquels je vais essayer de la retracer. Tous ne nous ont malheureusement pas été conservés, et je serai obligé de suppléer à quelques-uns d'entre eux par des documents postérieurs qui les mentionnent ou en donnent la substance.
Parmi les titres dont on doit le plus regretter la perte, figure en première ligne l'acte de fondation de l'abbaye, qui avait déjà disparu à la fin du XVIIe siècle. C'est ce qu'attestent les religieux eux-mêmes, lorsqu'au mois de décembre 1700, ils sont obligés, en vertu de l'édit du 10 janvier de cette année, de présenter leur déclaration au duc de Lorraine.
« L'abbaye, disent-ils, ayant été brûlée deux fois, la première sur la fin du siècle passé, et la seconde en ce siècle, par le malheur des guerres, elle ne peut presque produire aucun titre spécifique de sa fondation ni des biens qu'elle possède, que par les reconnaissances qui en ont été faites en 1628, 1629, 1630 et 1631... On sait seulement, par quelques fragments qui nous sont restés en copies non signées, et par quelques titres sauvés de l'incendie, qu'elle a été fondée par Albéron de Montreuil, archevêque de Trêves; Pierre, son frère; Béatrix, leur nièce; Séguin et Gérard, enfants de ladite Béatrix. L'un d'eux conte d'ailleurs cette fondation par la vie d'icelui seigneur archevêque, en ces mots : In patrimonio suo quod Monasteriolum dicebatur abbatiam construxerat, in qua reguîares canonicos magnœ religionis et sanctitatis viros collegit; vocaturque claustrum Bellus campus.»
Ce village de Montreuil, duquel Albéron et sa famille empruntaient leur nom, a depuis longtemps disparu, et nous ne savons pas au juste où il s'élevait, ainsi que son église et son château, où l'on croit que l'archevêque de Trêves vit le jour. Un acte de 4751 , conservé dans les papiers de la mense canoniale de Belchamp (sujet de consulte sur la cure de Belchamp et le vicariat perpétuel de Méhoncourt) , contient, à ce sujet, le passage suivant :
« On ne sait ou étoit l'église de Montreuil. Quelques-uns l'ont supposée sur un monticule dit le Saut-de-Montreuil, proche Méhoncourt ; d'autres sur la montagne où est Belchamp ; d'autres, enfin, dedans ou proche le château de Méhoncourt, qu'on croit être l'ancien Montreuil, qui a changé de nom. Ce qui favorise ladite conjecture, c'est que tout ce qui est donné aux chanoines in allodio de Montreuil, se trouve à Belchamp ou aux environs, ou à Méhoncourt, dont il n'est point parlé dans la charte de confirmation...»
La première supposition me semble la meilleure, et il faut admettre, je crois, que le village de Montreuil était bâti sur les flancs du monticule qui porte encore son nom, et dont le sommet était couronné, sans doute, par le château et l'église.
Dans sa Notice de la Lorraine (t. I, col. 106), Dom Calmet s'exprime ainsi : Belchamp, abbaye de chanoines réguliers de Saint-Augustin, de la réforme du B. Pierre Fourier,... fut fondée, vers l'an U30, par Albéron de Montreuil, princier de la cathédrale de Metz, et depuis archevêque de Trêves. Cette abbaye étoit connue, dans les premiers temps de sa fondation, sous le nom de montagne de la Sainte-Trinité (Mons Sanctœ-Trinitatis), qui lui est resté jusqu'au XIVe siècle, qu'on lui a substitué celui de Belchamp...»
Cette opinion parait donc être celle de Dom Calmet, lequel a cru pouvoir indiquer aussi l'époque de la fondation de l'abbaye : « Pierre de Monsterol, frère d'Albéron étoit, dit-il dans Histoire de Lorraine, l rC éd., t. II, col. 52, un seigneur plein de piété. Ces deux frères formèrent ensemble le dessein de fonder sur leur terre une abbaye de chanoines réguliers, qui s'établirent d'abord au village de Méhoncourt, d'où ils passèrent ensuite au Mont de la Trinité, où ils bâtirent une église dédiée à Notre-Dame et à saint Barthélémy. Durand en fut le premier abbé. On fixe sa fondation en l'an 1155, et Hillin, archevêque de Trêves, donna, en 1157, un privilège par lequel il confirme cette fondation, et où il rappelle les noms de Pierre de Monsterol ou Montreuil, et d'Albéron, fondateurs de ce monastère. L'armée protestante brûla cette abbaye en 1587, et l'incendie en consuma la plupart des chartes et des documents. »
L'assertion de Dom Calmet au sujet du nom donné à la montagne sur laquelle s'établirent les religieux de Belchamp et des saints sous le patronage desquels fut placée l'abbaye, est confirmée par divers titres, où l'on trouve cette dernière appelée ecclesia Sanctœ-Trinitatis Bellicampi, monasterium Sancti-Bartholomei de Bellocampo, et monastère de Noire-Dame de Belchamp.
La charte de l'archevêque de Trêves, dont il vient d'être parlé, n'existe plus en original ; nous n'en possédons que des traductions ou des copies, notamment celle que l'abbé de Senones a fait imprimer dans les preuves de son Histoire de Lorraine (Tome II, pr., col. ccclj) ; elle contient l'énumération des biens que possédait alors l'abbaye, savoir : l'alleu de Montreuil (de Mosteruel) avec les terres cultivées et incultes, les bois, vignes, prés, ban, serfs et servantes, donnés par Albéron et sa famille; l'autel paroissial du même lieu, donné par Henri, évèque de Toul ; l'alleu et l'église de Zincourt (de Ysincourt) ; l'alleu de Vaxoncourt (de Vassoncourt) avec une partie des dîmes et un moulin ; l'alleu de Villers (de Villare), près Saint-Remy-aux- Bois; l'alleu d'Essey-la-Côte (de Hassay) ; celui de Marainviller (de Malenviller), avec l'église, l'autel et les dimes; ceux de Nolferes (lieu inconnu) et de Blainville-sur-1'Eau (de Bullinville); l'alleu de Haigneville (de Haigneville), avec la moitié des dimes ; ceux de Bassompont (de Basompont),de Rozelieures (de Roseolis), de Barbonville (de BarunvUle) et de Charmois (de Charmeyaco) ; l'église de Damelevières (de Dompna-Libaria) avec l'autel et les dimes ; le siège d'un moulin sur la Moselle avec le droit de pèche ; deux poêles à la saline de Vie ; les dîmes de l'église de Villacourt ; le droit de pâture sur les bans de Moriviller (de Muriville) et de Clayeures (de Clausuris).
En 1168, l'évêque de Toul Pierre de Brixey confirme la donation faite à l'église de la Sainte-Trinité de Belchamp (ecclesie Sancte Trinitatis Bellicampï), par Mathieu de Chaumont (de Cuvomonte), chevalier, d'une partie des dimes dudit lieu avec le droit de patronage et la moitié de tout l'alleu (cette charte existe en vidimus) .
Ce village qui, de même que celui de Montreuil, donnait son nom à une ancienne famille, a complètement disparu ; un moulin, dépendant de la commune d'Einvaux, dont Chaumont était encore la mère-église au commencement du XVIe siècle, indique probablement la place qu'occupa cette localité, qui eut quelque importance autrefois, et dont la dénomination rappelle involontairement celle d'une des anciennes circonscriptions territoriales de notre pays (le Chaumontois).
Par une autre charte, datée de la même année, Pierre de Brixey confirme la donation faite par Gilbert de Blainville, de son alleu et de l'église dudit lieu; cette donation fut confirmée de nouveau, par l'évêque Odon, en 1292 et 1293.
La duchesse Berthe, femme de Mathieu 1er , morte vers 1195, confirma aussi (on ne possède qu'une copie informe de cette charte) la donation faite aux religieux du Mont de la Sainte-Trinité, par Pierre de Brixey, de la cure de Brémoncourt (de Bremuncort) avec le tiers des dimes.
En 1203, Mathieu de Lorraine, évêque de Toul, compatissant à la pauvreté de l'abbaye, lui donne, pour les posséder à perpétuité, les cures de Vaxoncourt, de Zincourt, de Damelevières et de Marainviller, avec le droit d'y nommer un de ses chanoines ou un prêtre séculier. Il lui confirme, en outre, l'église de Brémoncourt, les chapelles d'Haigneville, deMontreuil, deVillacourt, de Saint-Remy, et celle des Aviots.
Au mois d'octobre 1209, l'abbé de Belchamp et le prieur de Thicourt font un accord par lequel ce dernier cède à l'abbé tout ce qu'il avait dans la dîme de Montreuil, moyennant un cens annuel en grains. Cette transaction, confirmée par l'abbé de Cluny en 1210, et par l'évéque de Toul l'année suivante, fut modifiée en 1554.
En 1230, Jean, primicier de Metz, à la requête de l'abbé de Belchamp, lui permet de faire desservir l'église de Villacourt (de Vilascort) par un de ses chanoines.
Un seigneur de Rosières, dont on ne dit pas le nom, «avait fait don à l'abbaye d'un petit four (fornellum) à faire du sel». Celle-ci l'abandonna, en 1235, à un bourgeois du même lieu, à charge de lui payer une redevance annuelle de quatre muids de sel.
Expansion et pillages
Si le monastère de Belchamp trouvait de pieux bienfaiteurs pour le doter et l'enrichir, il n'était pas, néanmoins, assez heureux pour échapper aux violences que les princes et les seigneurs se croyaient permises, même envers les établissements placés sous la sauvegarde de la religion. C'est ainsi qu'en 1255, on voit l'abbé et les chanoines se plaindre à l'évêque de Toul de ce que Catherine (de Limbourg), autrefois duchesse de Lorraine, Ferry 1 , son fils, et plusieurs de leurs gens, avaient commis de nombreuses injures envers eux et envers leurs serviteurs, leur avaient extorqué une somme d'argent et s'étaient livrés à d'autres exactions. Le duc fut mandé devant l'évêque, témoigna du repentir de ce qui avait eu lieu et jura que de pareils faits ne se renouvelleraient plus, se soumettant d'avance, dans le cas contraire, à l'excommunication. Ferry ne se borna pas à cette promesse : voulant indemniser l'abbaye des dommages qui lui avaient été faits, soit de son chef, soit de son commandement, et aussi pour le salut de son âme et de celles de ses prédécesseurs, il lui donna plus tard (1294), en aumône perpétuelle, vingt sous toulois à prendre annuellement sur la taille de Blainville.
Une note, écrite en marge du cartulaire de Belchamp, en regard de la copie de cette pièce, porte « Ferri qui fut prisonnier à MaxévÏlle par ses soubjetz ».
Dans cet intervalle, les revenus de Belchamp s'étaient encore accrus : en 1292, Errard de Vandières et sa femme lui avaient abandonné ce qu'ils avaient à Bainville (in villa de Blainvilla), tant dans les dimes que dans le droit de patronage de la cure. La même année, Alexandre de Prény (de Prigneio), chanoine de Toul, avait reconnu et confirmé la donation faite par Gauthier, seigneur de Haussonville (de Hassonvilla), son père, du patronage de l'église de Saint-Mard (de Sancto-Medardo supra Mosellam).
D'autres donations, plus ou moins importantes, furent encore faites à l'abbaye dans le cours des siècles suivants ; mais il serait superflu de les mentionner toutes. Les documents de cette nature, lorsqu'ils remontent à une époque éloignée, présentent un grand intérêt pour l'étude de la géographie ancienne du pays ; cet intérêt diminue à mesure qu'ils se rapprochent des temps modernes, et ils ne peuvent plus servir que de renseignements.
Ce qui avait eu lieu en 1255, au préjudice du monastère, se renouvela, un siècle environ plus tard, de la part d'un seigneur appartenant à l'une des plus puissantes familles du pays : en 1569, Elme de Linange, ne pouvant récupérer une somme de mille petits florins d'or dont le duc Jean lui était redevable, envahit les terres de l'abbaye, pilla les villages de Marainviller et de Thiébauménil et emmena ou dissipa plus de huit cents tètes de gros bétail et causa du dommage pour plus de deux mille petits florins. Les religieux s'adressèrent au duc pour être indemnisés des pertes qu'ils avaient supportées, et celui-ci, mu de pitié, déclara que tous les héritages et autres biens qu'ils avaient sous la juridiction et sergenterie de la prévôté de Rosières, dont les officiers ne cessaient de leur causer des griefs, torts et oppressions, seraient désormais sous la juridiction et sergenterie de la prévôté de Lunéville; que, lorsque les gens du pays seraient mandés en armes, ils pourraient retenir de leurs hommes trois batteurs, un meunier et deux fourniers pour battre, moudre et cuire pour leurs nécessités ; moyennant laquelle grâce, ils rendirent au duc deux « arrêts » qu'ils tenaient de lui de la somme de cinquante-cinq petits florins pour vente de blé dont ils n'avaient pas reçu le paiement.
Afin de se mettre pour l'avenir, eux et leurs biens, à l'abri des déprédations des gens de guerre, et ne plus être exposés, comme ils l'avaient été souvent, à fuir leur maison et aller au loin mendier leur nourriture, les chanoines de Belchamp résolurent, en 1399, de construire dans l'enceinte de leur monastère, et près de l'église, une tour solide qui pût leur servir de lieu d'asile. Ils convinrent, dans une assemblée capitulaire, que, pour hâter cette construction, ils y affecteraient les biens d'un de leurs confrères qui venait de mourir, plus les vingt florins que chaque nouveau religieux était tenu de payer lors de sa réception.
Cette tour, de forme carrée (quaclrata turris), devait appartenir pour les deux tiers à l'abbé et pour l'autre tiers aux chanoines, et ils nommaient conjointement le portier préposé à sa garde; c'était le prieur claustral, le sacristain ou un autre délégué du chapitre qui en tenait les clés.
Les précautions prises par l'abbaye de Belchamp pour éviter les spoliations dont elle avait été souvent l'objet, furent impuissantes à l'en préserver : ainsi, au temps des guerres du duc Charles II, elle eut encore à souffrir « plusours gros et griefz dompmaiges », et ce prince lui donna (1415), par forme d'indemnité, le droit de pâturage et d'affouage à charge de célébrer chaque année un anniversaire pour lui, sa sœur la duchesse, ses enfants, ses prédécesseurs et successeurs.
En 1456, les déprédations se renouvelèrent, et l'abbé Gauthier de Lunéville, à qui son grand âge ne laissait plus assez de forces pour déployer l'énergie suffisante, crut devoir se démettre de sa dignité : « propter bella que hoc tempore vigebant, monasterium nostrum raultipliciter in suis redditibus, proventibus, juribusque et emolumentis fuerit damnificatum ».
Ce n'étaient pas seulement les barons du voisinage qui se permettaient des violences envers les religieux ; leur exemple était suivi quelquefois par les habitants des villages environnants ; c'est ce qui eut lieu, notamment, le 6 juin 1466, de la part de ceux de Méhoncourt, sujets à Ferry de Savigny. Pour un motif qui n'est pas connu, « aucuns dudit Méhoncourt, acompaigniez du maire condit le maire des chastis, vinrent on clos de Belchamp, entrairent violemment en la chambre de l'ung des religieux, en laquelle prinrent certains gaiges, rayarent serres, rompirent certaines huisses et firent autres offenses ». Plainte fut adressée au prévôt de Rosières, puis portée devant le bailli de Nancy, et les parties s'étant soumises au jugement d'arbitres, ceux-ci prononcèrent une sentence portant : «.... que le dimanche ensivant, jour de leste de la Trinité, Gérard Madowe, dudit Méhoncourt, soy disant maire des chastis, accompaignié de deux autres hommes dudit Méhoncourt, sans aucune dérision, et eulx vestuz honestement, comme il appartient, pour cause d'amendise, doient comparoir personelement en l'église dudit Belchamp, environ heure de prisme ou de grant messe, en présence de mondil sieur l'abbé et des religieux, ung chacun d'eulx ung genou à terre, la teste dacouverte, en disant ausdits seigneurs abbé et religieux que des offenses, forces et violences et oultrages par lesdits de Mehoncourt commis et perpétrez on clos dudit Belchamp, indchuement et sans cause, ilz en crient mercy ausdits seigneurs abbé et religieux, en eulx priant, pour l'amour de Dieu, qu'ilz leur veullent pardonner, et lesdits abbé et religieux leur doient pardonner. Les quelles choses ilz ont fait d'ung costé et d'autre, audit jour et lieu, par la forme et manière dessusditc...»
Les offenseurs furent condamnés , en outre , à une amende de 14 fr. 8 gros « pour les coustenges et frais soustenus par le prévost ».
Pendant la guerre entre René II et Charles-le-Téméraire, les gentilshommes lorrains qui s'étaient enfermés dans la forteresse de Vaudémont, étant venus faire des courses en la terre de Châtel-sur-Moselle, ceux de cette terre, aidés par les gens des seigneurs de Bayon, se mirent à leur poursuite : les Lorrains cherchèrent un asile dans la tour de Belchamp ; mais leurs ennemis les y assiégèrent et, «par force de feu», les contraignirent à se rendre. Plusieurs furent tués, les autres menés prisonniers à Châtel.
Nonobstant les lettres de sauvegarde qu'elle avait obtenues du duc François Ier en 1544, l'abbaye eut encore beaucoup à souffrir, peu d'années après, « pour raison des guerres et pilleries faites par les gens de guerre passans et repassans ». Afin de remédier aux désastres qu'elle avait éprouvés, l'abbé obtint, en 1569, du vicaire général de l'évêché de Toul, une sentence en vertu de laquelle le prieur et les religieux durent se contenter, pour un certain temps, des deux tiers de leurs prébendes.
Jusqu'alors, l'abbaye n'avait guère eu à se plaindre que d'actes de dévastation et de pillage commis sur les terres qui formaient son domaine; ce fut à elle-même que s'en prirent, au mois de septembre 1587, les bandes conduites par le trop fameux Guillaume de La Marck, duc de Bouillon, « huguenot, qui menoit proche de quarante mil hommes de mesme secte, bruslant et saccageant les ecclises ». L'armée protestante, après avoir dépouillé le monastère, y mit le feu, et celui-ci perdit une portion de ses titres, conservés précieusement dans la chambre ou l'arche pratiquée , probablement , dans un des étages de la tour; l'église elle-même fut souillée, profanée (poilu ta et contaminata ab hœreticis) et ruinée en grande partie. L'abbé Thierry de Lemainville s'empressa de la réparer et tâcha de lui rendre sa première splendeur. Mais il fallut du temps pour effacer la trace des dégradations qu'elle avait subies, et ce fut seulement treize années plus tard, le 1 er octobre 1600, que l'évêque de Toul, Christophe de La Vallée, put venir la réconcilier et y consacrer plusieurs autels. Toutefois, il parait que les tours ne furent réédifiées qu'au commencement du XVIe siècle , sous l'administration intelligente et paternelle de M. Massu de Fleury, élu abbé en 1695.
La règle de Belchamp
Après avoir raconté l'histoire de l'abbaye de Belchamp, je vais essayer de faire connaître sa discipline, ses règlements intérieurs et les révolutions qui s'accomplirent dans son gouvernement. Dans deux Registres qui font partie de ses archives (l'un de ces registres est intitulé : « Remarques sur la fondation de l'abbaye de Belchamp, tirées des vieux titres de l'archive dudit lieu; l'autre : Etat général des biens et droits de la manse canoniale ».), je trouve, à ce sujet, les détails suivants, écrits par des membres de son chapitre : L'abbaye a été gouvernée, depuis sa fondation jusqu'en 1597, par dix-huit abbés réguliers.
Après la mort du dernier titulaire, qui était Théodore de Lemainville, les capitulants abusèrent du droit d'élection : au lieu de prendre pour abbé un de leurs confrères , ils choisirent (17 janvier 1607) M. de Ligniville, prévôt de l'église collégiale Saint-Georges de Nancy, qui eut recours à l'évêque de Toul pour faire confirmer son élection , à l'exemple de tous les abbés réguliers qui s'étaient comportés ainsi jusqu'en 4470. A cette époque, ils recoururent à Rome pour se faire donner des coadjuleurs, à l'exception de Théodore de Lemainville, qui laissa, en mourant, le droit d'élire. « M. de Ligniville ne posséda point l'abbaye, malgré les précautions qu'il avait prises. Le cardinal de Lorraine la fit mettre en commende par un modu proprio du pape Paul V, du 29 décembre 1607; elle fut donnée à Charles de Lorraine, fils naturel du prince François, comte de Vaudémont, et les fruits en furent réservés à Charles, fils légitime du même prince; il les tira jusqu'en 1617. Le 4 janvier de cette année, le pape cassa cette réserve et en fit une seconde en faveur du prince Nicolas- François , à charge de payer une pension de cent écus à l'abbé commendataire. En 1651, le prince Nicolas-François, qui était cardinal diacre et évêque de Toul, quoiqu'il ne fût que réservataire des fruits de l'abbaye de Belchamp, la permuta pour celle de Saint-Avold, avec M. de Bourlémont, qui la posséda jusqu'en 1669. Ce fut pendant la réserve et la commende dont il vient d'être parlé, que la réforme du B. P. Fourier eut lieu à Belchamp (Voir : Histoire du B. Pierre Fourier, par M. l'abbé Chapia, t. I, p. 239. Au t. II, p. 236 et suiv., sont imprimés les statuts de la congrégation de Nôtre-Sauveur). Le pape Grégoire XV en chargea M. des Porcelets, évêque de Toul, qui fit signifier le bref aux anciens chanoines réguliers de cette maison , le 6 février 1625, et donna ensuite sa commission au P. Fourier, alors curé de Mattaincourt. Le prince Nicolas-François ayant été élu évêque de Toul en 1626, introduisit à Belchamp des chanoines réguliers réformés, qui prirent possession du temporel et du spirituel, le 27 août de cette année, et commencèrent immédiatement le service divin. Par acte du même jour, ils se chargèrent de payer pension à ceux qui sortaient et n'avaient point accepté la réforme. »
Outre les règlements généraux auxquels étaient soumises toutes les maisons de leur ordre, les chanoines de Belchamp en avaient de particuliers, qui déterminaient les rapports de l'abbé avec les religieux et les droits réciproques de l'un et des autres. Car ces petites républiques monastiques, quelle que fût, d'ailleurs, la piété de leurs membres , n'étaient pas complètement à l'abri des passions qui s'agitaient autour d'elles : des conflits s'élevaient souvent, touchant l'exercice de l'autorité et le maintien de certains privilèges, entre la communauté et son chef, et il s'en suivait des discordes intestines qui nuisaient au bien spirituel et temporel de tous.
Dès l'année 1360, les religieux et l'abbé, pour assurer la paix et la tranquillité dans leur monastère, dressèrent, d'un commun accord, des statuts destinés à donner aux premiers « certaines commodités qu'ils n'avaient pas auparavant, tant par rapport aux babils, linges, etc., qu'à cause du réfectoire, qu'ils voulaient être bien servi ».
L'abbé, y est-il dit entre autres choses, ne pourra, sans le consentement du chapitre, contracter des dettes pour une somme de plus de dix livres, monnaie de Lorraine. Il ne pourra, sans la même condition, engager ni aliéner aucune portion du domaine de l'abbaye ; nommer le célérier, le sacristain, le prébendier ou le pitancier. II n'aura pas les clés de la chambre ou de l'arche dans laquelle sont conservées les chartes du monastère. Il fera préparer, chaque jour, aux religieux, aux heures accoutumées, un potage suffisant et honnête (potagium sufftciens et honestum), cl il aura soin qu'il y ait des meubles convenables (suppellectilem honestam), tant à la cuisine que dans l'intérieur de la maison; etc.
En 1400 et 1454, des difficultés, peu sérieuses, s'élevèrent entre les chanoines et leur abbé au sujet du partage de la succession laissée par deux membres du chapitre, et on eut recours à des arbitres qui décidèrent que le partage en aurait lieu par moitié.
A cette dernière époque, l'abbaye de Belchamp était gouvernée par Vauthier ou Gauthier de Lunéville, lequel, au dire de ses religieux, intriguait en cour de Rome et près de l'évêque de Toul pour leur faire enlever le droit d'élire leur abbé et les priver de leurs anciennes franchises et coutumes. Afin de résister à ces empiétements du pouvoir abbatial, les chanoines assemblés firent dresser, par un notaire le 14 décembre 1454, un acte solennel de confédération, par lequel ils s'engagèrent à s'unir contre leur abbé pour le maintien de leurs privilèges.
La forme de celle pièce, la violence qui règne dans l'expression, lui donnent une certaine analogie avec les pactes de communes que faisaient les bourgeois du moyen-âge pour résister à leurs seigneurs.
Deux ans après, le 24 juillet 1436, l'abbé et les chanoines, réunis en assemblée capitulaire, au son de la cloche, suivant l'ancienne coutume, pour délibérer sur la diminution du nombre des chanoines, qui les empêche de vaquer aux rites et usages prescrits par les règles de leur ordre, décident que l'abbé pourra présenter à deux prébendes canoniales deux personnes propres à recevoir l'habit religieux, et les chanoines une, lesquelles seront examinées par l'abbé, le prieur et un des plus anciens du couvent, et ne seront reçues que si elles en sont jugées dignes. Ils règlent ensuite les conditions sous lesquelles les enfants (impubères) pourront être admis dans le monastère ; la somme à payer par les nouveaux chanoines lors de leur réception, etc.
Un an s'était à peine écoulé qu'un autre sujet de discorde s'élevait entre l'abbé et ses religieux, ceux-ci alléguant que, de sa propre volonté, sans motif de correction, mais trop arrogamment, il voulait leur imposer l'obligation de jeûner, tant le samedi que le jour de la lune (die lune) qui précédaient la fête du Saint-Sacrement, sous peine de l'excommunication, leur ayant fait ôter les vivres qu'ils avaient droit de recevoir, et ayant enjoint au prieur de leur faire enlever un monceau de poussière qui se trouvait hors des murs de l'abbaye, dans la partie au delà du bâtiment de la pitancerie.
Cette protestation contre les empiétements du pouvoir abbatial, non moins violente que celle de 1434, fut remise entre les mains de l'Official de Toul, dont on ne connaît pas la sentence.
En 1471, sous l'administration de Viriet de Clayeures, il y eut, au sujet de la diminution du nombre des chanoines, une nouvelle délibération capitulaire, à peu près conforme à celle de 1456. On y trouve, comme dans cette dernière, le passage suivant relatif à l'admission des enfants impubères : « Statuimus quotl si alique persone presententur et admittentur, taies persone debebunl sequi studium donec ad pubertatem pervcnerinl ut melius bonis moribus et litteratura inslruintur; nec diclo tempore prebendam récipient in dicto monasterio. »
L'admission des enfants n'avait lieu que sous certaines obligations assez bizarres, dont l'énumération se trouve ainsi indiquée dans une réponse faite à Antoine de Ville, bailli de Vosge, à l'occasion de la demande par lui faite d'un prébende (Au dos de cette pièce, qui doit être du commencement du XVIe siècle, on lit : Ce qu'il falloit donner anciennement pour être reçu dans cette maison) .
» Premièrement, il fault pour la chappe, le jour de la réception que l'enfant sera receu xl francs.
» Item, premier et avant que de donner l'abil à l'enflant, il fault donner pour la chappe xl francs. Et après, quant il luy plairait faire prendre l'abit à l'enfant en touillant seurté de satisfaire et payer quant aux chozes cy après escriptes.
» Premier, pour la réception de l'enffant fault faire ung paste, assavoir que, la vigille devant la réception, il fault nourir les religieulx, abbé et tout le couvent, avec les serviteurs domesticques d'icelle église, comme il est de coustume, ensembles tout le jour de la réception. » Item , entretenir l'enffant à l'escolle jusques ad ce qu'il serait en l'eaige et souftîsant pour le recevoir à la dicte église.
» Item , après ce qu'il sera receu à ladicte église pour aller aux ordres, pour son épistre, il fault taire le pasie comme dessus.
» Item, pour l'évangille, il fault faire le paste comme dessus.
» Item, pour la nouvelle messe il fault faire le pasle pour lesdits sieurs abbé et couvent, comme dessus. Et si tant estoit qu'il pleust au père de luy faire dire sa nouvelle messe en aultre lieu qu'en ladicte église, il fauldra faire le paste au retour, le lundi et mardi, comme dessus.
» Item, pour une chacune fois que ledit enffant yrait aux ordres, il doit ausdits sieurs abbé et prieur de ladicte église une paire de Cousteau. Et pour la nouvelle messe, chacun ung bonnet. Et chacun des religieulx une paire de gan pour la nouvelle messe avec des cordeaulx, comme il est de coustume.
» Item, après ladicte nouvelle messe, ledit religieulx doit sur la table abbacial et convenlualle dudit couvent, quaitorze stiers de vin.
» Item, doit au barbier d'icelle église, pour la tonsure dudit enffant, la somme de dix gros.
» Item, au cellérier de ladicte église, dix gros. » Item, pour le verlet dudit sieur abbé, dix gros.
» Item, pour le cuysenier de ladicte église, dix gros.
» Item, doit fournir les boix pour faire la cuysine de tous lesdits pastz devantdits, et tout ce qu'il fault à ladicte cuysine, comme il est de coustume. »
Lorsque, en 1567, il fut question de nommer un coad- juteur à Antoine Thiéry de Girmont, à qui son grand âge et sa faiblesse ne permettaient plus de gouverner l'abbaye, les chanoines profitèrent de cette circonstance pour revendiquer leurs privilèges et s'en assurer la possession. Dans une assemblée tenue le 7 février, ils firent le traité suivant, que chacun d'eux jura solennellement d'observer, dans le cas où il serait appelé à la coadjutorerie :
« Nous les prieur et couvent de l'esglise et monastère de Belchamps.... désirans et procurans à toutte diligence paix, concorde, union et commun accord de nostre maison estre observez, gardez et maintenus entre noz seigneurs abbez futurs ci nous les frères claustriers, présens et aussy futurs ; congnoissans que , pour le plus grand proffit, honneur et utilité de nostredicte maison, nous sommes raisonnablement contrains,... à cause de la débilité et faiblesse... de nostre père abbé,... faire élection canonicque d'ung coadjuteur....; dont, avant... ladicte élection, nous religieux proffès en ladicte église,... concluons, statuons, ordonnons et promettons en tesmoings d'ung chacun de nous, en la main de nostre prieur claustral, que celuy d'entre nous, soit claustral ou curé, qui sera à cest effect esleu... pour coadjuteur, par le tesmoingnaige de son seing manuel qu'il appliquera aux présentes, quant, de la parte dudict prieur, sera prié et requis, par l'asseurance duquel il nous promettera que, touttes et quantesfois qu'il sera requis de la parte dudict prieur ou successeur et des frères claustraulx dudict monastère, il passera une lettre en parchemin, munye et fortifiée de sa signature manuelle , de celle d'ung notaire de la court de Rome, et à laquelle seront attachez les deux seaulx de nostre maison, asçavoir abacial et conventuel, pour mieulx estre entretenue en son entier à l'advenir; en laquelle lettre seront contenus les articles cy- après déclairez et escriptz. » Premièrement, nous sera accordée la mesure de vin de nostre prébende, qui peult environ contenir ung peu davantaige que la pinte, mesure de vin de Lunéville; de laquelle prébende on a usé anciennement en nostredicte maison,.... et que la juste mesure d'icelle prébende soit mise et posée aux Chartres desdicts religieulx perpétuellement pour estallons, sans ce que lesdicts futurs seigneurs abbez y ayent aulcune chose à contredire; la- quelle mesure ung chacun religieulx aura deux fois le jour plaine de vin sain et net. » En oultre, nous voulons qu'en ladicte lettre il quitte entièrement, sans jaimais répetter, la pittance que lesdicts seigneurs abbez cy-devant vouloyent accoustumer prendre sur nostre pittance, tant en argent qu'aultres choses, à cause qu'il n'y a de quoy à payer, et que d'icelle n'avons lettres aulcunes ne tiltres pour la deffendre. » Pareillement , qu'il donnera à ung chascun religieulx buicl misches de pain blanc, comme de coustume ancienne, chacun jour. » Item , donnera les trenches de lard avec le potaige chacun jour. » A touttes les solemnitez et jours de loingtemps nommez abbaciaulx, il fournira le double, asçavoir une prébende de rottis et l'aultre de boully, telles et quelles aux jours fériaulx.... » Item, fournira à nostre prébende, tous les ans, ung demy cent de frommaiges venant de la bergerie dudief lieu. » Chascun jour de jeusne (saulf les veilles sollemnelles) il donnera à un chacun religieulx quattre misches de pain et une quarte de vin, à la collation, quattre misches et une quarte de vin pour tous les religieulx ensemble. » Item, aux vendredis il donnera à chascun sept misches, le vin ordinaire. » Durant les temps de caresme et adventz, comme les jours de jeusne , saulve qu'il donnera à chascun religieulx deux misches à la collation et trois aux advenlz, et une quarte de vin pour tous ensemble. Il fournira aussy tout le sel à seller tous pottaiges et chairs, tout le vin à cuyre le poisson, venaigre, verjus et aultres saulces en tout temps. » Item, tous les jours de caresme fournira les poix ou febves fris avec le potaige et beulre à y mettre. » Fournira le boys tant pour la cuisine que pour noz couvent. » Fera accouslrer loutte l'esglise et le corps (ficelle de toultes choses (saulve le petit clocher qu'est aux religieulx). Sera aussy tenu à faire et refaire et accoustrer les couventz (c'est-à-dire les bâtiments conventuels), tant d'esté que d'hyver, touttes et quanlesfois qu'ilz en auront nécessité. » Item, fournira une estable à mettre le cheval du prébendier et procureur, ensemble toute paille et foin. » Il n'aura aussy aulcunemenl à congnoistre sur les renies et revenus des cbappelles de fondation, ains seullement aura esgard au service d'icelles à cause des gaiirnaiges qu'il en reçoyt. » Il n'aura aussy à congnoistre ny à demander quelque usaige ny ouverture du troisiesme grenier de la tour, lequel est ausdicts religieulx, ny aussy sur les Chartres estantes en ladicte tour, ny en tout ce qui est dedans. » Finablement, que ledict n'aura puissance recepvoir aulcun guerson pour prendre l'habit de céans, sans le consentement du chapittre... » Thiéry Courrier, qui administrait la cure de Blainville, ayant été choisi pour coadjuteur, ratifia en ces termes l'engagement qu'il avait pris de concert avec les autres chanoines : « Tesmoing ma signature cy-dessoubz mise le 7 e d'apvril 1570, je promect d'accorder la pétition cy- dessus escripte touchant l'argent de pittance et les cinquante fromaiges, pourveu qu'il y a bergerie suffisante ad ce, sçavoir excédant desdicts cinquante fromaiges la despence qu'on en poulroit faire à la maison, et ce seulement ma vie durant. Quant aux aultres articles, je me veulx reigler à l'ancienneté, sans admettre ou entendre que je sois subject par la présente signature d'y accorder puys après si je ne les trouve raisonnables par l'advis des plus anciens religieulx, soyent religieulx curez ou clostral. » Ces réserves du nouveau coadjuteur devaient faire prévoir des conflits pour l'advenir, et, en effet, Thiéry Courrier était à peine parvenu à la dignité abbatiale, que déjà ses anciens confrères étaient en lutte avec lui. On en trouve la preuve dans la pièce suivante, où sont renouvelés à peu près tous les griefs qu'ils avaient formulés auparavant, et à plusieurs reprises, contre leurs abbés. Cette pièce est assez curieuse, dans le fond et dans la forme, pour que je croie devoir en reproduire une partie. « Déclaration de ce que les frères du chapittre et couvent de l'abbaye et monastère de Belchamps, ordre Sainct- Augustin,... proposent et allèguent pour certains différente que semblent à disputer entre leur révérend père abbé cl eulx par-devant la révérence de monseigneur l'évesque et comte de Toul ou de monsieur le suffragant et vicaire général duclit seigneur et de monsieur l'official. » Remonstrent avec toutte humilité... qu'avec leur grand regret et faulcherie, .présentement ilz sont contrains retourner vers mondict seigneur de Toul à l'occasion de ce que (selon leur jugement) ilz sont grevez et molestez de leurdict sieur abbé et supérieur, ou du moins espèrent à l'être (s'attendent à l'être) par beaucoup de choses qu'il leur semble directement contrevenantes aux antiques institutions de leur maison... Touttesfois, ilz ont tousjours différé, tant pour ne contrevenir à ceste unité que tant de fois est recommandée si charitablement à leur profession (comme le nerf d'icelle), comme aussy pour ce quilz avoyent espérance que monsieur leur abbé... estant à eulx coétané et nouvellement appelle à ceste dignité du temps desdicts du couvent, il leur feroit quelque bon traictement en recongnoissance, ou du moin ne leur derrogeroit rien de leurs privilèges et imunitez. Mais, voyant qu'il persiste à telles conceptions, et y a apparence qu'il se parforce à leur tôlier et osier ce que tant curieusement ses prédécesseurs leur ont conservé et inviolablement gardé ci tousjour adjousté plustost que diminué;... avec le conseil de beaucoup de gens de bien, proposent et allèguent les articles cy-après déclairez (les articles sont au nombre de 22. Dans le premier, les chanoines rappellent les statuts de 1360 comme leur litre constitutif) . » Hz requièrent qu'il soit commandé à monsieur leur abbé se désister de la poursuylte qu'il faicl envers le sainct siège apostolicque pour l'union à sa crosse des bénéfices qui en dépendent et desquelz, à cause de sa dignité abbatialle, il a le droict de collation, pour ce que telle union seroit grandement préjudiciable ausdicts religieulx et successeurs d'iceulx, d'aultant que, de tous temps immémorables , leurs prédécesseurs tousjours en ont estez prouveuz par leurs révérends abbez lorsqu'il sont venus à vacquer » Quant à touttes les affaires qui se présentent à traicter capitulairement, ilz demandent s'il est loisible à monsieur en pouvoir décider par son seul jugement et advis ou puissance et aucthorité , ains , après avoir convocqué le chapittre, fault nécessairement qu'il se conforme à l'oppinion de la plus grande et saine partye d'icelluy... » S'il advenoit qu'ung, plusieurs ou tous ensemble lesdicts religieulx fussent grevez à tort et sans cause de la parte du sieur abbé ou d'aulcuns de ses serviteurs,.... ilz requièrent (s'il est raisonnable) de pouvoir faire sonner la cloche du chapittre le lendemain matin ou prochain vendredy, pour y faire comparoir monsieur premièrement et conséquamment tous les frères, là où paisiblement ilz luy puissent remonstrer et faire entendre de là où procéderoit le cas advenu et sur ce y conclure avec raison pour l'advenir.... » Protestant que, s'il advenoit (ce que Dieu ne veulle) quelque stérilité, et que, à cause d'icelle, on les voulût reigler sur ce que leur est dheu, de n'en diminuer ou rabbattre aulcune chose, si donc n'est qu'en temps de fertilité ilz ayent la congnoissance de la distribution des rentes.... » Pour aultant que monsieur estant distraict par beaucoup de négoces et affaires urgentes pour la charge de son estât... et que, pour satisfaire à ce, affin que les religieulx ne soyent sans chef et conducteur, partout l'office de prieur soit esté, dès le commancement, ordonné et institué à telle intention que, comme le sieur abbé est ordonné sur le soing de la temporalité, aussy le prieur ait la cure de la spiritualité; à ceste occasion ilz requièrent que ledict prieur soit maintenu à tout ce entièrement qui dépend de son office et comme, de toutte ancienneté Ton a accouslumé à leurdicte maison, et comme l'on usent présentement en beaucoup de monastères, à sçavoir qu'il ait puissance donner licence ausdicts religieulx d'aller hors dudict monastère pour certaines affaires qu'il trouvera raisonnables (exceptez les loingtains voyaiges), les réprimer et punir, si mestier faict, avec le conseil de ses confrères, pour petiltes faultes commises au sainct service, ou n'y avoir assisté, et aultres plusieurs qui ne sont si grefves, comme aux réfectoirs et aultres lieux, qu'il soit nécessaire que monsieur y ordonne ou d'en avoir oppinion du chapittre.... » Maintiennent lesdicls religieulx. que, tant et si longuement que monsieur est absent de sa maison, durant ledict temps il ne doibt participer à leur portion de chair et poisson, considéré que eulx estants aussy absenlz ne participent à celles de pain et vin que monsieur leur doibt par chacun repas..., et que cela serait grandement pénible ausdicts religieulx qu'ung serviteur, mangeant quelquefois chair, comme aux adventz, vienne touttesfois à prendre et choisir le meilleur poisson de leur plat, non que pour ce ilz en soyent en si grande peine, mais pour ce que la raison n'y est pas.... » Et pour aultantque le prébendier ne poulroit exécuter lestât de son office allant à pied, il luy est permis avoir ung cheval (lequel le sieur abbé fournissoit anciennement des siens) qui doibt estre nourry à la maison... Et pour ce que... ledict prébendier, pour son aide, anciennement prenoit ung serviteur de la maison et le menoit aux champs avec lny pour l'aider à achepter et amener chair ou aultres choses, lesdicts religieulx entendent que, par mesme moyen, le cuisenier du sieur abbé aille quelquefois aux champs avec ledict prébendier... pour achepter et amener quelques bestes, comme bœufz, veaux ou moutons, à la maison, et les tuer, parmy son droict. Soit aussy tenus ledict cuisenier faire boullir et rottir leurs chairs et poissons dheument, comme il s'appertient, à la cuisine, et leur administrer incontinent qu'ilz auront faict la bénédiction aux réfectoires, soir ou matin, et pour ce ilz luy octroyent, comme il a heu par cy-devant, une pièce comme l'ung d'eulx; laquelle, toutesfois, ilz ne veullent qu'il preine que le dernier de tous, si ce n'est de leur congé. » Qu'aux réfectoires, tant d'esté qued'hyver, aux disnez et souppez, lesdicts religieulx soient servis de linges honorables , à scavoir : par chacune sepmaine une nappe blanche pour le moin, et la rechanger aux bons jours qui surviennent parmy la sepmaine, selon la coustume ancienne. Leur soyent aussy administrés linges honnestes pour essuyer leur vasselle, et aultres choses requises à leur estât, et que ladicte vasselle soit de mesme, affin qu'ilz ne se persuadent que l'on ne faict grand compte d'eulx, qui sont touttesfois les enffans propres de la maison et employez à la plus grande et principalle charge. Et à cause de deffault de telles petittes choses, le murmure s'acroit le plus souvent en grandes disputes. Qu'en hyver, au disné et souppé, le sieur abbé leur face délivrer du bois suffisamment lorsqu'il ne luy plaira faire mettre sa table au réfectoire. Et combien que il soit porté par leurs Chartres que bien peu d'hommes laïcz soient admis à leurs réfections , touttesfois ilz veullent bien que ledict sieur abbé admette à sa table ceulx que bon luy semblera, pourveu que si quelcung faisoit insolence de faict ou propos, sobdain il soit reprins et admonesté de modestie, comme l'on a tousjour faict du passé ; pourveu aussy que si le sieur abbé, au disné ou souppé, estoit empesché ou hoirs de la maison, ou attendant aulcungs, ou qu'il voulût plus demeurer à table que l'ordinaire à cause de ses assistans, il soit loisible, l'heure estante venue, faire la bénédiction de la table et rendre grâces après les repas et soy retirer sans estre contrains attendre davantaige. Et, tout du loing de l'hyver, la cuisyne ne leur soit deffendue pour se chauffer, allantz et revenantz de l'esglise, aultrement, qu'on leur face ung lieu chaulx pour soy retirer, ainsy qu'on en voit user par tous les monastères. » Quant il sera nécessité de recepvoir des jeusnes novices pour estre religieulx, les susdicts entendent que la mesme forme qu'anciennement s'observoit à telles choses, soit gardée, à sçavoir que cela se face par le consentement du chapittre. . . . » Que lesdicts religieulx ne soyent attenus sonner les grosses cloches aux jours de festes et solemnitez, d'aultant que cela est l'office des serviteurs de la maison, ny pareillement en esté, pour le temps et nuées, si ce n'est aux jours ouvriers , que lesdicts serviteurs soyent aux champs... » Comme aussy soit que, de leur bonne volonté, par cy-devant, ilz se soyent libéralement offert à aider foiner, moissonner et vendanger, touttesfois, parce que de leur volunté on en a faict une coustume que de les tenir à l'ouvraige comme ouvriers, sans récompense, jusqu'à telle heure qu'il plaisoit , à ceste occasion ilz diffèrent d'aller foiner, mais se présentent d'aider à moissonner les bledz, vendanger et faire le vin depuis les matines jusques à la grande messe et depuis nonne jusqu'aux vespres.... » Prient aussy qu'il plaise à monsieur ne leur poinct deffendre l'administration des sacrementz, d'aultant que l'ordre ny leur profession ne les en a jamais exclus.... » Ilz requièrent que les articles que furent accordez à l'élection de monsieur, soient gardez et mis en exécution, sans y diminuer aulcune chose, comme choses très raisonnables et accordées fraternellement et par commun accord, sans fraude ny déception quelconque.... »
Tels étaient, en résumé, les griefs, pour la plupart bien futiles, qui suscitaient des querelles entre les chanoines et leurs abbés, et faisaient naître, au sein du monastère , ces discordes civiles qu'on voit se perpétuer pendant plusieurs siècles. On ignore en faveur de qui se prononça l'autorité ecclésiastique, car les archives de Belchamp ne renferment aucune des sentences prononcées, soit par l'évêque, soit par l'Official de Toul.
Ainsi que je l'ai dit précédemment, une révolution s'accomplit, au commencement du XVIe siècle, dans l'abbaye de Belchamp : après avoir été mise en commende, elle fut, peu après, soumise à la réforme du B. Pierre Fourier.
Déjà, quelques années auparavant, une tentative avait été faite dans ce sens : le 22 février 1597, les chanoines écrivaient à l'abbé de Saint-Pierremont, chargé de la réforme et de l'union des chanoines réguliers, une lettre dans laquelle ils disent que : sommés de comparaître à Saint- Pierremont, le 20 avril suivant, pour entrer en congrégation et traiter des affaires concernant l'état et amplification de leur ordre, selon les décrets du concile de Trente et suivant l'ordonnance du cardinal de Lorraine, ils sont prêts à établir une bonne et canonique réformation, à ce que les trois vœux de religion soient, au mieux que faire se pourra, désormais observés en leur monastère, n'entendant, néanmoins, recéder de leurs prélatures, droits, immunités, juridictions spirituelles et temporelles, ni autres privilèges et dignités accoutumés de temps immémorial et portés par leurs institutions et titres canoniques. Ils déclarent consentir à être visités par celui qui sera élu en la congrégation triennale; etc.
« En 1623, porte un document conservé dans les archives de l'abbaye, M. des Porcelets, évêque de Toul, ayant reçu du pape Grégoire XV un bref qui lui ordonnait de visiter toutes les maisons des chanoines réguliers de Lorraine et Barrois et d'y établir, par sa vigilance pastorale, la discipline régulière, qui y était presque abolie , ce bref fut signifié à Belchamp, le 6 lévrier, par le sieur Gérard, prévôt de la collégiale d'Haussonville. Le lundi suivant, le prélat y vint faire sa visite et y établit plusieurs règlements pour obvier aux désordres qui augmentaient de jour en jour. Le cardinal Nicolas-François, administrateur des revenus de l'abbaye, sollicité par l'exemple de plusieurs maisons qui avaient pris la réforme, pressa vivement ses religieux de les imiter. Il donna des bénéfices à ceux qui refusèrent de l'accepter, ou des pensions proportionnées à leur état, que l'on prenait, avant toutes choses, sur les biens de la mense conventuelle. Le traité d'accommodement et d'introduction fut fait le 27 août 1626 », dans la forme suivante :
« Nous Charles de Lorraine, abbé et seigneur souverain de Gorze, abbé commendataire du monastère de la Très-Saincte Trinité et de la Benoiste Vierge Marie de Belchamps (le prince Charles s'était démis de l'abbaye en faveur du cardinal Nicolas-François, mais avait conservé le titre d'abbé) , ordre de Sainct Augustin des Chanoines réguliers, diocèse de Toul ; désirans de contribuer de tout nostre pouvoir au restablissement de la discipline réglière audict monastère, et d'y introduire la forme et manière de vivre religieuse restablye es monastères dudict ordre, et de la congrégation de Nostre Sauveur, à laquelle le mesme monastère avoit esté uny et incorporé par feu... Jean des Porceletz, évesque et comte de Toul,... nous nous serions transporté audict monastère de Bel- champs, et là fait entendre nostre intention et obligation aux sieurs prieur et religieux d'icelluy assemblez en leur chapitre, et les exhortez et admonestez de se disposer à vivre en ladicte congrégation, et selon les observances régulières receues en iceile. Sur quoy lesdicts sieurs prieur et religieux ayans communicquez et traictez par ensembles, selon la coustume de leur chapitre, nous auroient faict entendre et remonstrer par les sieurs Nicolas Thiéry, prieur, et Dominicque Jaquemin, religieux, qu'ils désireroient grandement de pouvoir vivre en ladicte congrégation, mais que, pour divers empeschementz , ils n'espéroyent pas de le pouvoir faire, nous suppliantz partant qu'il nous pleust leur donner et assigner telles pensions sur le revenu de la mense conventuelle, que nous trouverions estre justes et raisonnables pour leur entretien, pour en jouyr cy après par chacun d'eulx , et moyennant ce , ils consentoient , en tant que besoing seroit, que les pères ei religieux de ladicte congrégation fussent par nous introduictz et receus audict monastère pour y faire le divin service et y résider, faire le couvent et chapitre et jouyr des rentes et revenus d'icelluy privaliveraent de tous autres. Ce qu'entendu par nous, après avoir meurement et exactement considéré et examiné Testât dudict monastère et du revenu d'icelluyvTàge, le temps de la profession et du service que lesdicts sieurs religieux ont rendu audict monastère, cl les divers enipeschementz qu'ils peuvent avoir d'entrer en ladicte congrégation, nous aurions trouvé juste et raisonnable de leur assigner... les pensions... que s'ensuivent. (Suit le détail des pensions assignées à chaque religieux.) » Et moyennant lesdictes pensions accordées comme dessus, nous avons ordonné et ordonnons, du consentement exprès desdicts sieurs prieur et religieux, que les dicts pères de la congrégation entreront dès maintenant en leur lieu pour faire, constituer et composer le couvent et chapitre dudict monastère, pour lever et percepvoir tous les fruietz, rentes et revenus, et jouyr de tous les droietz, privilèges, immunitez,.... desquelles les religieux dudict monastère ont jouy,.... et que, dès le jourd'huy vingt-septiesme d'aoust, veille de la feste du glorieux patriarche sainct Augustin, ils commenceront l'office divin solemnellement, aux premières vespres, et le continueront par après; duquel aussy nous avons deschargé et deschargeons pour tousjours lesdicts anciens religieux, et leur avons permis... de se retirer hors dudict monastère, chacun en tel lieu qu'ils choisiront de nostre consentement , pour y vivre soubs la charge et jurisdiction de leurs supérieurs ordinaires, honnestement et selon la mo- destie religieuse. En foy de quoy nous avons signé les présentes de nostre main et y fait apposer nostre cachet en placart, et les faict contresigner par le notaire apostolique souscript. Expédié audict monastère de Belchamps, le vingt-septiesme jour d'aoust mil six centz vingt-six... /. Virion, notaire apostolique. »
Le 4 septembre 1627, un traité, passé entre les religieux et l'abbé, confirmé par Urbain VIII, le 1 er octobre 1628, régla la séparation des menses abbatiale et canoniale : les chanoines eurent dans leur lot les bâtiments réguliers et le jardin, la moitié de la grosse tour, les gagnages de Loro et de Rozelieures, les cures de Laneuveville-aux-Bois , Saint-Mard, Vaxoncourt et Einvaux, la chapelle de la Madelaine et des héritages en divers lieux ; les revenus de la pitancerie, du vestiaire et des fondations, à condition qu'ils desserviraient la cure de Méhoncourt ; que les abbés ne leur fourniraient plus le pain et le vin; qu'ils seraient chargés des aumônes et de l'hospitalité, des ornements de la sacristie et de l'église, des réparations des bâtiments réguliers, excepté dans les cas de ruines occasionnées par la guerre, le feu, la tempête ou autres accidents fortuits, dans lesquels l'abbé serait tenu d'y contribuer pour moitié.
Ces clauses furent modifiées à la suite d'une transaction passée, le 50 mars 1678, entre les chanoines et leur abbé, M. de Lozanne : il fut convenu, entre autres choses, que l'église serait à la charge de ce dernier, pour toutes sortes de réfections, comme aussi les cloches, orgues, livres de chœur, missels, argenterie et autres ornements ; la fourniture des chapes, chasubles, tuniques, etc., pour officie:* aux jours solennels; que les linges pour la sacristie et les autels seraient à la charge du chapitre, de même que les bâtiments et le cloître, quant aux réparations or- dinaires, les autres devant avoir lieu à Irais communs par le chapitre et l'abbé.
Je ne rappellerai pas les traités ultérieurs, ni les nombreux procès auxquels donna lieu la séparation des menses, notamment sous l'administration de M. de Bouzey, grand doyen de la Primatiale de Nancy, nommé par Stanislas en 1742. L'abbaye de Belchamp semble avoir été condamnée à vivre dans une agitation perpétuelle, en dépit des efforts tentés pour y faire régner la discipline ecclésiastique, et le choix d'abbés tels que le marquis de Boufflers, bien qu'ils ne la possédassent qu'en commende, était peu propre, il faut en convenir, à ramener les religieux aux idées qui avaient présidé à la création des institutions monastiques.
Les Abbés de Belchamp
La plupart des abbés auxquels fut confié le gouvernement de ce monastère n'ont laissé après eux aucun souvenir, et c'est même tout au plus si l'on connaît les noms de plusieurs d'entre eux : il y en a quelques-uns, en effet, qui ne sont désignés que sous des noms de baptême, qui ne nous apprennent pas à quelle famille ils ont appartenu.
Une liste des abbés de Belchamp est également | donnée dans l'histoire de Saint Norbert |
J'ai cru devoir, néanmoins, pour compléter cette monographie, essayer d'en dresser une liste (Dom Calmet en a donné une en tête du tome III (col. 1 xxiv) de son Histoire de Lorraine; mais elle s'arrête à l'année 1693. On en trouve une plus complète dans la Gallia Christiana, t. XIII) , aussi exacte que possible, à l'aide des documents qui nous ont été conservés, notamment d'après le registre intitulé : « Remarques sur la fondation de l'abbaye de Belchamp » (les dates placées à la fin de chaque article sont celles des chartes dans lesquelles les abbés sont mentionnés) :
- Durand , auquel Hillinus , successeur d'Albéron à l'archevèché de Trêves, adressa sa charte de confirmation des biens de Belchamp. 1157, 1168*. Suivant Dom Calmet, Durand est nommé Durandus abbas Sanctœ-Trinilalis dans un titre de l'an 1150, dont il ne donne pas l'indication. Il est qualifié abbas Bellicampi dans une charte de Mathieu 1er (1152) pour le prieuré de Beaulieu (Cartulaire de Belchamp, f° 1).
- Hugues, mentionné dans la charte de la duchesse Berthe, dont il a été parlé p. 257 : Hugoni, abbati, cunc- lisque [fra tribus] in monte S. Trinitatis canonicam vilam professis (Cartulaire de Belchamp, f° 1). Il signa, en 1178, la charte de fraternité entre le chapitre de Saint-Dié et l'abbaye de Beaupré (Dom Calmet).
- Lybardus. 1185 (Dom Calmet).
- Richardus. 1185 (Dom Calmet).
- Humbert. 1203. Charte de Mathieu, évêque de Toul, pour l'abbaye de Belchamp : Humberto, abbati Belli- campi (Cartulaire, f° 1 v°).
- Barnabe. 1210. Venerabilis abbas Bellicampi dominus Barnabas. 1253. Charte d'un seigneur de Rosières : Venerabilis vir B., abbas Bellicampi (Cartulaire, f° 2).
- Dom Calmet donne pour successeurs à Barnabe : Hamil, Hugues II, lesquels, dit-il, ne sont connus que par quelques fragments et par la tradition;
- Guillaume. 1310.
- Jean. 1316.
Les Remarques sur la fondation de l'abbaye mentionnent les abbés Henri, qui vivait en 1313, et Hamil, en 1384. II n'y est pas question de Hugues II, de Guillaume, ni de Jean. D'un autre côté, on trouve, dans les titres de Belchamp : Thierry. 1304. Henri. 1354. Frater Henrieus, dei patientia, humilis abbas monasterii Bellicampi (Cartulaire, f° 4).
- Albéron de Rosières. 1364. Albero de Rouzieres.
- Albert de Lunéville. 1365.
Etant devenu incapable, tant à raison de sa vieillesse que de ses infirmités, de gouverner l'abbaye, Albert résigna entre les mains de l'évèque de Toul, qui commit à sa place Guillaume (Villermum), curé de Damas et doyen de la chrétienté d'Epinal, pour administrer jusqu'à l'élection canonique d'un abbé; à la suite de laquelle fut choisi, en 1407, Albert de Rozelieures (Albertus de Rozeluris) , prieur claustral, dont l'élection fut confirmée par l'évêque.
Il eut pour successeur Jacques de Lunéville, lequel résigna près du Saint-Siège, en 1428, et ce dernier pourvut Vauthier ou Gauthier de Lunéville (Walterus ou Valtier us de Lunarisvilla). Ce choix n'étant pas agréable aux religieux, ils éliront, après le décès de Jacques, Nicolas de Fléville, chanoine régulier, dont l'élection n'eut pas d'effet, et l'abbé Gauthier jouit paisiblement de son droit. En 1456, devenu vieux et infirme, il demanda à l'évêque de Toul de déléguer Nicolas de Fléville, prieur claustral, pour l'aider dans son administration.
Gauthier eut pour successeur Jean Thirion, de Rozelieures, qui résigna en 1470.
Le 11 avril de cette année, le chapitre élit, pour être abbé après sa mort, Jean Champion, chanoine régulier, qui fut confirmé par l'évêque de Toul, le 4 mai, mais gouverna à peine l'abbaye, car, le 20 juin de la même année, des bulles furent données à Jean Viriet, de Clayeures, sous la réserve d'une pension de 20 florins pour Jean Thirion.
Il résigna, le 21 mars 1495 (Dom Calmet dit, par erreur, qu'il était mort en 1490) (1496), sous la réserve d'une pension de 40 florins, en faveur de Thiéry Georges, dit Petitpain, de Bayon, comme lui chanoine régulier.
Ce dernier eut pour coadjuteur, le 18 novembre 1502, Jean Cousson, de Rozelieures, qui mourut le 21 février 1531 (1532).
Il avait demandé et obtenu pour coadjuteur, en 1530 (et non 1560, comme le dit Dom Calmet), Antoine Thiéry de Girmont, qui devint abbé en 1532 et mourut, suivant Dom Calmet, le dernier février 1575.
Des bulles de coadjutorerie avaient été données, en 1563, à Antoine Thiéry, de Domêvre, que l'on assigne pour successeur à Thiéry de Girmont, et, en 1572, à Thiéry Courier, de Lemainville, qui est quelquefois appelé simplement Thiéry de Lemainville. Il mourut, dit Dom Calmet, le 27 janvier 1607.
Le 30, le chapitre élut Philippe-Emmanuel de Ligniville, prévôt de la collégiale Saint-Georges de Nancy. Cette élection fut confirmée par le grand-vicaire de Toul, mais le pape n'accorda pas ses bulles. Charles II en demanda et en obtint pour son fils naturel Charles de Remoncourt, à qui, par un molu proprio, Paul V donna l'abbaye en commende, le 29 décembre 1607. Les fruits en furent réservés à Charles de Lorraine, fils légitime du même prince, à charge de payer à Charles de Remoncourt une pension de cent écus d'or.
Une bulle du même pape, du 1°' janvier 1617, cassa cette première réserve et en fit une en faveur du prince Nicolas-François, avec la même charge d'une pension annuelle de cent écus d'or pour l'abbé commendataire d'alors ou autres titulaires après lui.
Le 5 juillet 1627, le cardinal Nicolas-François permuta l'abbaye de Belchamp contre celle de Saint-Avold avec Charles d'Anglure de Boorlémont, conseiller du roi en tous ses conseils, archevêque de Toulouse, qui obtint ses bulles le 8 octobre 1631. Charles de Lorraine était encore commendataire en 1630.
Le 16 mai 1663, sur la fausse nouvelle de la mort de M. de Bourlémont, le chapitre élut M. Cousson, qui fut confirmé par l'évêque de Toul, le 18 du même mois. Cette élection n'eut pas d'effet, et M. Cousson mourut même avant celui qu'on l'avait appelé à remplacer.
Jean-Claude de Lozanne fut élu canoniquement le 31 octobre 1669, confirmé par l'évêque le 2 novembre suivant, et bénit dans l'église Saint-Léon de Toul, le 22 mai 1678. 11 eut trois compétiteurs : 1° en 1671, Guillaume de Barclay, mort le 17 janvier 1672; 2° en 1672, Claude Drouot, doyen de la Primatiale de Nancy, nommés tous deux par le pape; 5° enfin, en 1673, Joseph de Gournay, clerc tonsuré du diocèse de Metz, nommé par Louis XIV. Ils furent l'un et l'autre déboutés de leurs prétentions, et M. de Lozanne continua à gouverner l'abbaye jusqu'à sa mort, arrivée le 25 février 1693. Il avait été assistant du P. général de la congrégation de Nôtre-Sauveur.
Son successeur fut Charles de Massu de Fleury, prieur de Moyeu vre, élu le 21 avril 1695, confirmé le 24 août et bénit le 29 septembre de la même année, à Belchamp, par M. de Thiard de Bissy, évêque de Toul.
A cet abbé s'arrête la liste donnée par Dom Calmet.
M. de Massu eut pour coadjuteur, en 1720, Jean-François de Kieckler, curé de Bouquenom (aujourd'hui Saar-Union), mort en 1741 (1) . « L'an 1720, dit-il, j'ai été choisi coadjuteur de M. l'abbé de Belchamp, où je m'étois rendu la veille. Le 1er , je fus remercier S. A. R. de son agrément et recommandation. Je fus aussi à Toul et à Metz voir M grs les évêques pour en avoir les certificats pour la cour de Rome. Le 3 e aoust 1721, j'ay été béni coadjuteur à Strasbourg par M. le suffragant (2) ».
(1) . Sa pierre tombale, en pierre dure bleuâtre, baute de deux mètres, existe encore, encastrée dans le mur de la chapelle Saint-François-Xavier de l'église de Saar-Union. Elle porte l'inscription suivante , qui surmonte ses armoiries : D. O. M. Hic jacet vcnerabilis et perillustris D. D. lohannes Franciscvs de Kickler, canonicvs regvlaris ordinis sancti avgvstini, coadjvtor consecratvs abbatis Belli Campensis, et hvjus ecclesiœ rector, vivens pavpervm fvit pater, et ipse pavper, sed dives virtvtibvs et meritis; obiit in Domino anno œtaiis svœ 62, die 14 mensis maii, anno 1741.
(2). Papiers de la cure de Saar-Union (communication de M. Arthur Benoit, de Berthelming).
A M. de Massu succéda, en 1743, Jean-Claude de Boizey, prélat domestique des signatures de grâce et de justice de S. S., conseiller-prélat en la Cour souveraine de Lorraine et Barrois, grand doyen de l'église Primatiale de Nancy.
Le dernier abbé commendataire de Belchamp fut Stanislas-Jean marquis de Boufflers (né à Lunéville le 3 mars 1735, mort à Paris, le 18 janvier 1815. Il repose au Père-Lachaise, sous une simple colonne, a côté de Delille et de Saint-Lambert), chevalier de l'ordre de Saint Jean-de-Jérusalem, noble génois, ancien gouverneur du Sénégal et dépendances, maréchal des camps et armées du roi, commandant en chef de l'île de Corée, abbé commendataire de Longeville, membre de l'Académie française, grand bailli d'épée du bailliage royal de Nancy (1788), président du Corps électoral, qui l'envoya à l'Assemblée nationale en 1789.
Les Sceaux de Belchamp
Quoique les titres en parchemin provenant des archives de Belchamp, soient en assez grand nombre, néanmoins les sceaux du couvent ou des abbés sont fort rares, et encore ceux que l'on possède sont-ils, pour la plupart, frustes ou mutilés.
Il ne reste que deux sceaux du couvent :
- le premier (n° 1 de la planche), appendu à un titre de l'année 1436, est presque complètement intact : il porte dans le champ la Sainte-Vierge tenant l'enfant Jésus, et assise sur le faite d'une église, de chaque côté de laquelle s'élève un clocheton fort aigu ; en bas est un personnage à genoux et les mains jointes. Légende : S[igillum] CONVENTVS BELLI GAMPI. Ce sceau, en ogive, d'un petit module et d'une belle exécution, est celui qu'on appelait le sceau ordinaire (iI a été, de même que les autres, dessiné par M. Louis Benoit, de Berthelming).
- le grand sceau, dont il n'existe qu'un exemplaire très fruste, appendu à un titre de 1552, semble représenter un personnage agenouillé, au milieu d'une espèce d'arcature ogivale ; le contre-scel est également fruste et la légende indéchiffrable.
Les sceaux des abbés sont aussi rares que ceux du couvent, car je n'ai pu en découvrir que deux, et encore sont-ils du même abbé , Jean Viriet de Clayeures , ou simplement Jean de Clayeures, comme il se nomme lui-même en tête de la charte, du M mai 1478, qui porte le sceau dont je donne le dessin (n°2) : Johannes de Cleuriis, permissione clivina, humilis abbas monasterii Bellicampi. Son nom est indéchiffrable sur ce sceau; mais le mot Wirieti se lit parfaitement sur un autre, accompagnant un titre du 20 août 1491. Celte date rectifie l'assertion de Dom Calmet, qui fait mourir Jean Viriet en 1490.
A ces deux sceaux il faut en ajouter un d'Antoine Thiéry de Girmont ou Antoine de Girmont, coadjuteur de Jean Cousson, et que celui-ci appela à sceller son acte de fondation de la chapelle du Saint-Sépulcre, le 20 février 1551 (n° 5).
Enfin , on possède deux exemplaires du cachet du prieur (n° 4), apposés à des pièces toutes modernes; ce cachet porte, dans le champ, le buste de Jésus-Christ tenant le globe crucigère de la main gauche, et bénissant de la droite. Légende : SIG [illum] CA [pituli] HEG [ularis] (ou canonicorum regularium) BEL [li] CAMP [i].
L'état de l'abbaye à la Révolution
On a vu précédemment qu'à diverses époques, l'abbaye de Belchamp avait eu à souffrir des dégradations , notamment en 1587, au passage des troupes protestantes; mais elle s'était toujours relevée de ses ruines, et lorsqu'éclata la Révolution, on n'eût jamais dit, à voir son église avec ses deux tours élancées, sa maison abbatiale, ses bâtiments conventuels et toutes les habitations groupées dans l'enceinte de son vaste enclos, qu'elle avait été ravagée plus d'une fois par le fer et par le feu.
L'ensemble de ces constructions présentait un charmant aspect, ainsi qu'on peut en juger par le dessin conservé à la bibliothèque publique de Nancy. L'abbaye et ses dépendances étaient placées au sommet et sur le revers d'un coteau; une enceinte de murs assez élevés, de forme irrégulière, renfermait, — outre l'église et les bâtiments abbatiaux et conventuels, une immense cour dans laquelle étaient construits le colombier, les écuries et les maisons des vignerons et métayers, — les jardins de l'abbé et des chanoines, le cimetière, etc. En dehors de l'enceinte et longeant la muraille qui la fermait, étaient des vergers, des vignes et d'autres terrains cultivés. A une des extrémités de la cour s'élevaient, présentant la forme d'un carré presque régulier dont un des angles était défendu par la tour construite en 1399, les bâtiments du monastère et l'église, qui dominaient toutes les autres constructions.
Voici, du reste, la description que nous a laissée de l'abbaye l'auteur des Remarques sur la fondation de cette maison:
« Le quartier abbatial est séparé par l'église de la maison conventuelle. Dans ce quartier, il y a deux aisles nouvellement rétablies par l'industrie et l'économie du très R. P. Charles Massu, abbé moderne et vivant; la première, qui abouttit sur l'église par un bout, a la face tournée vers Bayon... Le haut de cette aisle est magnifique et inspire une idée de grandeur à ceux qui sont curieux de le voir. Une grande allée plafonnée et bien éclairée réjouit ceux qui s'y promènent : le monde racourcy sur des cartes, des fortifications de villes exprimées sur du papier, un arrangement industrieux de ces tables, font passer le temps à ceux qui ne peuvent pas s'arrêter ailleurs. Dans cette allée, qui est médiocrement longue, il y a trois portes : l'une qui conduit à l'église par un escalier où l'on descend, musnie d'un beau et grand placard où paroissent l'industrie et la délicatesse de l'ouvrier. Au milieu, il y en a une autre placardée ; par elle on entre dans une petite salle, de laquelle on va dans deux belles chambres qui sont à ses côtés, où rien ne manque pour le bon nécessaire. La troisième porte conduit dans une chambre où il y a un billard, et de cette chambre on va au jardin par une platteforme de bois, inventée ingénieusement par le très R. P. abbé.
» La seconde aisle est différente de la première, en ce qu'elle n'a point d'allée, ny en haut, ny en bas. Dans le bas, auprès du maître escalier qui conduit à l'appartement d'en haut, il y a une salle d'une assez médiocre grandeur, revestue de boisure et de tapisserie; suit une chambre où Son Altesse Royale couche lorsqu'elle nous fait l'honneur de venir icy....
» Au milieu de ces deux aisles, qui prennent presque tous leurs jours d'un côté, il y a une cour bien pavée. A côté droit en entrant dans l'aisle qui abboutit sur l'église proche la porte qui y conduit, c'est un four, ensuite, en montant, c'est un petit jardin à fleurs, qui est terminé par une petite loge...
» Toute la bassecour est entourée de murailles assez eslevées, du côté de Bayon. Dans cette bassecour il y a plusieurs maisons où logent les métayers du très R. père abbé....
» Pour avoir une juste idée de tout ce détail, il faut concevoir un grand quarré, à un grand vuide au milieu ; tout autour de ce quarré sont tous ces bàtimens dont j'ay parlé, et, au milieu, il y a un grand colombier qui appartient, avec toutes ses maisons et jardin, la réserve ôtée, audit très R. père abbé. L'église et la tour qui est au bas de l'église, fait partie de ce quarré. Devant l'église est une fontaine et un gué pour laver les chevaux. Auprès de celte fontaine est le portail de l'église, que le seigneur abbé a fait faire avec bien de la dépense; de là on entre dans la tour. Devant la maison abbatiale il y a un grand espace de terrain, entouré de murailles, qui fait un fort bon effet.
» Du côté de Bayon, ledit très R. père abbé a un beau et grand jardin... a côté de ce jardin, qui est entouré de murailles, est la grande allée qui conduit à l'abbaye, large d'environ vingt-quatre pieds et longue d'environ soixante. De l'autre côté de ladite allée est le cimetière et une partie de l'hostel abbatial. Devant cette allée il y a une grande croix de pierre et un chemin voisin, qui, d'un côté, conduit à Lunéville, de l'autre, à Bayon... »
Plus loin, en parlant des « droits du seigneur abbé dans son abbaye », l'auteur des Remarques dit : « Il y a un carquan attaché à la porte pour punir les malfaiteurs, les coureurs de jardins, voleurs et autres de cette nature. Il y a une prison pour renfermer ceux qui causent du trouble dans sa seigneurie.... La moitié de la tour lui appartient contre ses confrères pour l'autre moitié ; c'est là où il fait ses greniers et ceux de ses fermiers ».
II n'est parlé, dans les Remarques, ni de l'église, ni des bâtiments conventuels, lesquels, au dire de Dom Calmet , avaient été rebâtis , sous l'administration de M, Massu de Fleury, avec toute la beauté et la bienséance convenables. On voit, d'après le procès-verbal descriptif rédigé en 1790, pour opérer la vente de l'abbaye comme propriété nationale, que ces bâtiments renfermaient treize chambres de religieux , à faire feu , et onze sans cheminées.
Ce procès-verbal ne fait pas mention de la tour; ce qui peut faire supposer qu'elle était détruite; mais sa démolition, si toutefois elle avait eu lieu, devait être toute récente, puisque cette construction figure encore sur le dessin fait par le frère llesselat en 1788. Ainsi que je l'ai dit, cette tour était carrée et un peu plus élevée que les bâtiments du monastère. Il est probable qu'elle l'avait été davantage dans l'origine, mais qu'elle avait subi des mutilations lors des incendies de 1476 et 1587.
L'église de Belchamp
Quant à l'église, le procès-verbal de 1790 se borne à dire qu'elle était vaste et bien entretenue, et, si l'on en juge par le plan joint au dessin dont il vient d'être parlé, elle aurait été très longue et fort étroite. Ce plan n'indique que deux chapelles : celle de la Vierge, à gauche du chœur, et celle de Saint-Augustin, à droite. Les archives de Belchamp ne contiennent aucun document relatif à la première; la seconde est mentionnée dans un titre de 1594, portant donation à son chapelain, Thierry de Ludres (de Ludia) et à ses successeurs, par Guillaume de Clayeures (de Cleare) et Jean de Vennezey (de Venexeyo), curés, de trois florins de cens annuel et perpétuel. En 1425, Jean, dit Chevreul, d'Einvaux, fonde et dote, à l'autel Saint-Augustin, une chapelle ou chapellerie (unam capellam seu capellaniam).
Sur la planche ci-jointe, on lit au-dessous du plan : « La partie habitée par le chapitre est tout-à-fait démolie, ainsi que la tour féodale à mâchicoulis, l'église et ses clochers ; il ne reste que le quartier abbatial, la basse-cour et les bâtiments d'exploitation, dont les malheureux habitants ne gagnent pas de quoi les entretenir. Le dernier abbé commendataire étoit l'aimable chevalier de Boufflers, et son dernier prieur, M. Drant, de Saint-Boing, mort au bagne de Rochefort au moment de sa déportation, en 1795 ».
D'autres titres mentionnent les chapelles ou autels ci-après :
- 1° Chapelle du Saint-Sépulcre et de Notre-Dame-de-Pitié. Par acte du 20 février 1551, l'abbé Jean Cousson ordonna et établit « une chapelle perpétuelle, scituée et érigée en l'église de Beauchamps, dicte la chapelle du Sainct-Sépulchre », près de la porte d'icelle église. Il semble résulter des termes de cet acte, que Jean Cousson en était le fondateur. La légende du plan n'en parle pas, mais c'est évidemment celle qui est cotée sous la lettre C, à l'entrée de l'église. On l'appelait aussi la chapelle de Notre-Dame-de-Pitié ; c'est, du moins, l'induction qu'on peut tirer d'un acte du 25 février 1509, par lequel Jean Brouvellain, de Moriviller, fonde une messe annuelle et perpétuelle à dire chaque semaine « en la chapelle de Nostre-Dame de Pitié, là où est le sépulcre, située auprès de l'entrée de l'église ».
- 2° Chapelle Sainte-Catherine. Le 20 août 1491, Nicol Cousson, religieux de Belchamp, fonde et établit une chapelle perpétuelle située en l'église dudit monastère et assise à « l'aultey Madame saincte Katherine ». En 1499, l'abbé Thiéry Pelitpain fait une donation à la même chapelle, assise « à la senestre partie du grant autel » ; d'où il paraîtrait résulter que c'était la même que la chapelle de la Vierge.
- 3° Chapelle Saint-Barthélémy. Le jour de l'Annonciation Notre-Dame, au mois de mars 1452, Warry de Fléville , chevalier ; dame Mengeay de Haussonville , sa femme, et Marguerite de Chambley, douairière et veuve d'André de Haussonville, fondent une messe perpétuelle à dire par chacune semaine en l'église de Belchamp, «à l'aultei Monsieur sainct Bartholomeu».
- 4° Chapelle Saint-Pierre. Le 25 janvier 1451, il est fait donation d'une partie d'un champ et d'un pré au chapelain de cette chapelle.
- 5° Chapelle Saint-Nicolas. Le 12 mai 1423, le maire Jean Loratte, d'Haussonville, et Isabelle, sa femme, établissent une chapelle perpétuelle à l'autel Monsieur saint Nicolas.
- 6° Chapelle Sainte-Croix. Par acte du 15 novembre 1597, Guillaume de Marainviller, chanoine de Belchamp et curé de Villacourt, attendu « l'utilitey, indigence et urgent nécessitey » que l'abbé et ses religieux « ont à présent, en faisant pluseurs réparacions , édifices et fortificacions de lor esglize », leur donne, pour convertir à ces réparations, édifices et fortifications, tout ce qui lui était dû par divers individus, réservé certaines créances, qu'il veut être « converties en la fundacion et augmentacion de la chapelle Saincte-Croix, estant et fundée en l'esglize de Belchamps », pour la célébration de messes à l'autel de cette chapelle.
- 7° Chapelle Saint-Etienne.
Le 19 mars 1452, Marguerite de Chambley, veuve de Jean de Fléville, fonde une messe à cette chapelle, laquelle, paraît-il, était érigée dans le cloître de l'abbaye : témoin un titre de 1435, portant fondation et dotation, par le chanoine Collin, d'Essey, d'une chapelle ou chapellenie in clauslro ecclesie monasterii, ad allure sancti Stephani.
Ces documents confirment ce que dit le procès-verbal de 1790 au sujet des vastes proportions de l'église; mais il ne fait aucune mention de ses décorations extérieures ou intérieures : tout ce qu'on sait à cet égard, c'est que Jean Cousson avait fait faire, pour être placé dans le chœur, un superbe pupitre en cuivre , ayant la forme d'un aigle ; qu'Antoine Thiéry de Girmont y avait fait mettre des stalles magnifiques, qui, au dire de Dom Calmet , étaient peut-être les plus belles de l'Europe; enfin, que M. Massu de Fleury avait enrichi le monastère d'une belle bibliothèque (notre confrère M. Arthur Benoit, de Berthelming, possède un volume provenant de cette bibliothèque ; le titre, écrit à la main, porte : Canoniœ Bello Campensi inscriptuê 1737 ; sous le fleuron du litre : Massu abbati de Bello Campo 1712) et l'église d'ornements précieux.
C'est probablement lui qui fit rebâtir les tours, puisqu'on fait dater leur reconstruction des années 1729 et 1750. Il est à présumer que les stalles furent brisées par les troupes protestantes et qu'elles servirent à attiser l'incendie qui dévora une partie du monastère.
Toujours est-il que l'inventaire du mobilier de Belchamp, dressé en 1791, n'en parle pas, tandis qu'il mentionne « un pupitre en cuivre superbe, en forme d'aigle ». Quant au trésor de l'abbaye, il faut supposer qu'il n'était pas très riche, car, si l'on excepte un certain nombre de vêtements ecclésiastiques en tissus plus ou moins précieux, l'inventaire en question ne relate que « deux bras en argent qui servaient de châsse pour des reliques ».
On voyait dans la nef de l'église les pierres tombales ou les épitaphes de plusieurs abbés : celles de Jean Viriet, de Thiéry Petitpain, de Jean Cousson et d'Antoine Thiéry de Girmont. La tombe de M. de Lozanne était dans le sanctuaire. Plusieurs membres de la famille d'Haussonville , morts dans le courant du XVe siècle, étaient aussi inhumés dans cette église. Mais, ce qu'on y remarquait surtout, c'était une inscription en lettres d'or sur un marbre noir, destinée à rappeler les fondations charitables faites par l'avant-dernier abbé, M. Claude de Bouzey, en faveur des habitants pauvres des villages où l'abbaye de Belchamp possédait des biens.
Ce monastère , qui avait subsisté pendant près de sept cents ans, fut vendu à la Révolution comme propriété nationale. On fut obligé de le diviser en deux lots, à cause de son importance : dans le premier furent comprises la maison abbatiale et ses dépendances ; dans le second, l'église et les bâtiments conventuels. Les acquéreurs démolirent d'abord ces bâtiments, la vieille tour à mâchicoulis , l'église avec ses beaux clochers ; ce fut ensuite le tour du quartier abbatial, et il ne resta bientôt plus rien, sur le mont de la Sainte-Trinité, de l'antique abbaye fondée par l'archevêque de Trêves Albéron de Montreuil.
